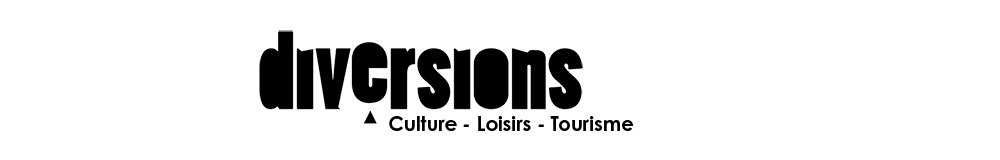ROMAN
Editions du sous-sol
Sortie le 19 août 2021
Le roman de Laura Vazquez paraîtra le 19 août prochain aux Éditions du sous-sol. Une première expérience de prose pour l’auteure originaire de Perpignan, avec tout de même beaucoup de poésie dedans ! Lors de cette Semaine perpétuelle, on croise une famille bancale, dysfonctionnelle comme on dit aujourd’hui, mais aussi une femme avec un œil sur la langue, des bébés « congelés, coupés, chauffés »… Vous l’aurez compris, La semaine perpétuelle n’est pas un roman ordinaire mais un long cheminement poétique où se croisent questions existentielles, violence sociale, problématiques de la fin de vie, du temps qui passe… Mêlant poème en prose libre et pure poésie, rap, émoji, jusqu’aux désormais incontournables commentaires du Net, Laura Vazquez nous offre une photographie de l’époque en s’intéressant à celles et ceux pour qui pencher la tête sur leurs téléphones portables est devenue « une chose simple et normale ».
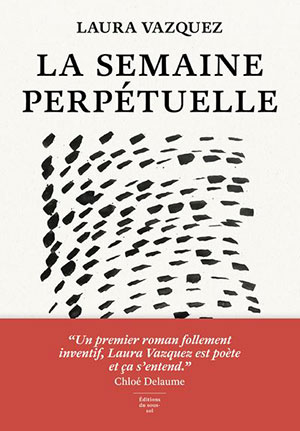
Diversions vous avait interviewée il y a quelques années lors d’une lecture à l’Espace Multimédia Gantner, à Bourogne dans l’Est de la France. Vous nous aviez donné un (trop) court aperçu de votre poésie. Cette fois vous sautez le pas en abordant pour la première fois la forme du roman.
Ça fait plusieurs années que la forme narrative apparait dans mes poèmes. De plus en plus il y a des personnages, et la forme du récit m’a toujours beaucoup intéressée.
Qu’est-ce que cela a changé dans votre manière d’écrire ?
J’ai traversé juste avant une sorte de petite crise existentielle d’écriture, qui a tout remis à zéro, et je suis repartie avec ce livre. Je l’ai commencé en 2017 et j’ai travaillé trois ans et demi dessus. C’est Barthes dans La préparation du roman qui parle du moment où ça prend, où dans l’écriture il se passe quelque chose. C’est un roman très habité par la poésie, l’un des personnages principaux écrit des poèmes !
Comment s’est faite la rencontre avec les Éditions du sous-sol ?
L’éditeur a choisi d’ouvrir son catalogue à la poésie depuis quelques années. Il a publié notamment une poète nord-américaine qui s’appelle Maggie Nelson et j’ai passé mon manuscrit à un ami qui l’a fait lire au directeur de cette maison d’édition. J’ai trouvé leurs choix très cohérents, leur catalogue et leurs livres très beaux. Ils m’ont dit qu’ils me suivraient aussi pour la poésie. Et ça c’était mon rêve d’avoir un éditeur qui publie à la fois mes poèmes et mes romans. C’est un éditeur qui m’a laissé beaucoup de liberté pour mon livre, qui n’a pas voulu le modifier, le faire rentrer dans une ligne éditoriale, donc ça se passe très très bien ! Il y a des spécificités, les parties avec les commentaires d’internet, les parties avec les poèmes, et après l’éditeur a adapté à sa charte graphique.
Dans La semaine perpétuelle, on retrouve des traits caractéristiques de votre poésie, comme ces répétitions qui impriment leur pulsation au texte. Mais si le poète est un sprinteur, le romancier est davantage un coureur de fond ! « On dirait que la nature essaie des choses. On dirait qu’elle essaie des formes », écrivez-vous. Cette phrase semble aussi s’appliquer à votre propre recherche.
Je mettais de la pression à l’écriture. Et puis j’ai eu cette espèce de phase où je me suis rendu compte que l’écriture et moi, c’était deux choses différentes et que je ne pouvais pas demander à l’écriture de me satisfaire moi. C’était plutôt moi qui étais au service de l’écriture, pour la faire aller bien, lui donner de bonnes conditions. Et à partir de là, de ce déclic, je suis devenue une travailleuse, tous les jours, je faisais mes heures d’écriture, et ça me satisfaisait simplement de faire de mon mieux. Ça a changé mon rapport et depuis je suis beaucoup plus régulière. Mon écriture a gagné en souplesse depuis ce roman, en intensité, peut-être en confiance aussi. C’est plus direct, plus vrai.
Il écrivait le premier mot, ensuite il entendait presque des voix, mais il n’entendait pas de voix, pas du tout, mais il les traduisait dans une langue.
Vos personnages, principaux ou secondaires, ne laissent pas indifférents. Comment avez-vous construit les personnages de Salim et sa soeur Sara, ou encore leur père obsédé par la propreté ?
J’avais déjà des personnages qui sont des mélanges, de gens réels, de personnages fictifs qui m’ont marquée. À partir de là venaient des scènes. Ça ne venait pas dans ma tête, mais en écrivant. Et une fois que j’ai écrit pas mal de scènes, je les retravaillais beaucoup. Par exemple la scène de la rencontre avec l’homme vieux dans la fontaine, j’ai dû la retravailler peut-être quarante fois. Souvent, j’ai en tête des lieux, par exemple des escaliers devant un théâtre, ça je l’avais bien en tête. Il y a une maison qui était une ancienne école, une chambre avec des miroirs.
Aviez-vous en tête l’idée de la famille de Salim ?
J’avais l’idée d’un personnage qui fait des vidéos sur internet, et puis il a eu un père. Je savais qu’il y avait une grand-mère, ça c’était sûr. Cette famille c’est venu tout seul. Je n’avais pas du tout l’idée d’écrire sur la famille, ce n’est pas un thème qui en soit me passionne, m’intéresse. Je pense qu’il y a des rapports entre les personnages profonds et viscéraux. Par exemple dans la manière dont un fils peut percevoir son père. Il n’y a que le fils qui peut percevoir le père d’une manière à la fois aussi détestée et adorée, avec un mélange de bonté, de pitié. Ces rapports-là sont quand même très profonds, donc très intéressants.
À force de baisser la tête sur cet appareil, tes organes vont descendre. Ils vont descendre par la bouche et tu vas vomir tes organes.
Le roman fait également une place importante aux mondes virtuels et aux réseaux sociaux en particulier.
Il y a plusieurs causes à ça. C’est quelque chose qui m’est très familier. Je passais beaucoup de temps sur internet à regarder des vidéos, qui ressemblent un peu aux vidéos que mon personnage propose dans le livre. Des vidéos de jeunes gens qui expliquent la vie, le monde, donnent des réponses aux grandes questions. Souvent ce sont des gens croyants, donc je regarde beaucoup de vidéos de jeunes musulmans qui répondent à des questions, et à chaque fois il y a des commentaires et je trouve que c’est souvent assez beau, et assez intéressant pour moi.
Salim préfère écrire des poèmes et les diffuser sur internet plutôt que d’aller dans ce « bâtiment gris » qu’est l’école. Il « essayait de fabriquer un sourire normal sur son visage », écrivez-vous encore, comme si l’on pouvait douter de son aptitude à ressentir des émotions, calquant ses expressions faciales sur des émoji. Et puis pendant un long moment, il n’est plus sorti de chez lui…
Je savais que le personnage principal serait un Hikikomori. Ce sont des personnes au Japon (mais ça arrive aussi en France et dans plein d’autres pays) qui ont décidé de renoncer à la vie à l’extérieur, et qui ne sortent plus de chez elles. Elles vivent devant leur ordinateur et ont une vie sociale, une vie courante sur internet. On a parfois des Hikikomori qui ne sont pas sortis depuis vingt, trente ans. Cette idée de renoncer au monde, d’une forme de suicide non accomplie, mais une forme de suicide quand même, m’a donné envie de raconter une histoire en lien avec ça.
Plus tard, on mettra Internet sous nos paupières.
Vous traitez également d’une certaine déconnexion avec le monde réel, quand internet permet parfois d’adoucir ce dernier à l’image des fameux filtres Instragram : « Pourquoi la réalité reste toujours trop près ? » se demande Sara. « Elle aurait voulu régler leurs visages avec son téléphone, régler le visage des passants avec un logiciel. Qu’ils soient plus flous, plus loin, moins vrais. »
C’est un thème qui revient pour beaucoup de personnages, également chez Jonathan, chez le père aussi, cette idée d’une réalité trop forte et trop près, c’est peut-être quelque chose de générationnel. Pour les personnes de ma génération, et pour les jeunes encore plus, c’est difficile en fait la vraie vie, c’est trop vrai ! C’est facile quand on s’est habitué à internet, de parler, il n’y a plus de timidité. L’image, on peut la contrôler. Par contre le monde réel c’est plus compliqué, il faut réagir tout de suite, et d’autant plus avec le confinement.
L’espace virtuel qu’est Internet peut aussi s’avérer particulièrement anxiogène.
Là, si quelqu’un meurt, que ce soit une célébrité, ou même une personne de notre entourage lointain ou proche, il y a de fortes chances qu’on l’apprenne sur internet, c’est très étrange. J’ai fait une résidence d’écriture à la fondation Michalski en Suisse. J’ai passé trois mois là-bas, et mon voisin qui vivait dans la cabane à côté est mort. J’ai vu un hélicoptère passer par la fenêtre, se poser devant moi. J’ai ouvert Facebook et là j’ai vu qu’il était mort. C’était vraiment très étrange et je pense que c’est très typique de notre quotidien.
Propos recueillis par Dominique Demangeot