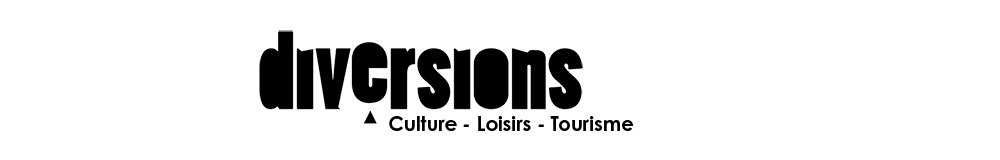ROMAN
Rivages
8 août 2013. Detroit. Les dernières tours de la cité du Brewster Project vont être démolies, ultime chapitre d’une longue agonie de la « Motor City » à partir des années 60. Jadis vitrine de l’industrie automobile toute puissante, la ville de Detroit a pris de plein fouet la crise économique de 2008, précipitant sa chute définitive et la laissant sous perfusion financière. C’est dans cette ville en lambeaux que nous emmène Judith Perrignon à l’occasion de son dernier roman.
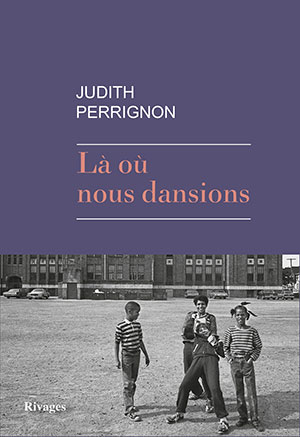
Dans le quartier du Brewster Project, un cadavre a été retrouvé une balle dans la tête. L’enquête est menée par deux policiers, Ira, approchant de la retraite, enfant du quartier, et Sarah, plus jeune, née elle aussi à Detroit. Judith Perrignon brosse un portrait lucide et sans concessions, souvent sombre, de la cité américaine déchue. Là où nous dansions est le résultat d’un minutieux travail d’enquête, l’autrice fouillant le passé de Detroit pour en déterrer les fantômes. Sous la terre repose l’ancien quartier de Hastings Street, qui accueillit les populations juives d’Europe de l’Est durant la première guerre mondiale, avant de devenir l’épicentre de la culture afro-américaine à partir des années 30. « Rouler vers Detroit, c’est aller vers l’obscurité », peut-on lire dans le roman. Mais certains n’ont de cesse de vouloir faire la lumière sur cette ville jadis glorieuse.
Detroit est-elle vraiment, comme le pense Ira, « un roman américain démodé » ? Plutôt un mythe, voire une mystification, lorsque l’on considère les destins de tous ces travailleurs afro-américains réunis dans les immeubles sociaux du Brewster Project. Judith Perrignon dépeint Detroit comme la cité de la fin des rêves et des idéaux, où le capitalisme s’assoit sur les droits sociaux et les syndicats. Le Brewster Project en est la parfaite illustration, miné par la criminalité et la drogue, connaissant une lente décrépitude à partir des années 60, « le début du vide ». Pour ne pas sombrer définitivement, il y a la musique qui irrigue tout le roman, de la soul façon Tamla Motown, au rock des années 90 qui se joue dans les caves, le blues de John Lee Hooker, le jazz, jusqu’à la techno du XXIe siècle. La musique, ascenseur social pour des filles du quartier comme The Supremes, un lien social aussi, ou simplement le moyen de « se sentir vivre ». La culture essentielle, n’en déplaise à ceux qui nous gouvernent.
C’est le rock et son engeance, spontané, a priori rien de cérébral, rien à expliquer, juste une charge physique, le sentiment de faire du bruit, l’intuition forte d’appartenir à quelque chose de plus grand que soi ».
D’une écriture précise, mais qui n’oublie pas de laisser dans son sillage de belles traînées poétiques, Judith Perrignon reflète également cet aspect fascinant des grandes villes américaines, ambivalentes à l’image de Detroit, « machine folle, huilée, qui tourne sans arrêt… ». En 2013 Detroit est néanmoins une ville qui s’efface, une partie de sa population paraissant tout aussi invisible, « comme si les gens d’ici ne comptaient pas, n’existaient pas », fait remarquer Ira. Aujourd’hui, on reconstruit dans le centre-ville. On redonne vie à des quartiers jadis désertés par la population blanche, en y édifiant des appartements luxueux pour les encourager à revenir. La roue tourne, mais on se demande déjà quand le prochain effondrement aura lieu. C’est tout l’intérêt du roman de Judith Perrignon, de remettre de l’humain dans cette tragédie américaine. Redonner la parole aux disparus, celles et ceux à qui on ne l’a jamais donnée, à l’instar de Sarah qui met un point d’honneur à retrouver l’identité de ce « Frat Boy » assassiné. Et puis après tout, il nous est toujours permis d’espérer. Des jardins potagers poussent parfois sous les ruines d’une station-service… Judith Perrignon est Française, mais elle vient sans doute d’écrire ici son grand roman américain.