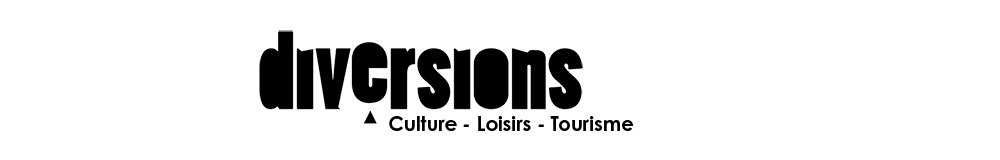En 1973 démarre à Besançon un mouvement social qui aura un retentissement national et même international, et en Allemagne et même aux États-Unis, on continue à s’intéresser au mouvement Lip. Ce 8 juillet Charles Piaget présentera le petit livre qu’il vient d’écrire, On fabrique, on vend, on se paie, Lip 1973 (éditions Syllepse, 2021) à la libraire Le Chat Borgne à Belfort, l’occasion de revenir avec lui sur la grève chez Lip, en ne se limitant pas à elle, parce qu’elle est aussi le résultat d’une activité syndicale construite patiemment au sein de l’usine durant plusieurs années. On verra dans les lignes qui suivent que Charles Piaget, s’il n’a jamais arrêté de militer, n’a jamais cessé non plus de questionner sa pratique en étant parfois très critique avec lui-même.

C’est la première fois que vous prenez la plume pour raconter votre expérience lors du mouvement Lip, j’imagine que les sollicitations n’ont pas dû manquer, pourquoi le faire maintenant ?
Non, pas vraiment. J’ai signé, à l’époque, des ouvrages collectifs qui étaient édités par le syndicat, mais tout seul je n’avais pas écrit. Je me suis dit qu’on n’avait pas assez fait ressortir certains points importants concernant la lutte, tout ce qui concernait l’émancipation. À Lip, on a beaucoup bossé sur ça, comment faire évoluer les gens.
Je me rappelle quand j’ai démarré chez Lip, il y avait plus de 1 000 personnes, j’étais impressionné. Quand je suis arrivé avec tous ces ateliers dispersés, je n’aurais jamais imaginé qu’il puisse y avoir une lutte collective. J’ai été agréablement surpris d’avoir, avec beaucoup, réussi à faire un collectif.
Dans votre ouvrage, vous employez très rarement le « je », vous insistez beaucoup sur la dimension collective du mouvement.
Il faut bien comprendre que l’entreprise c’est tout sauf un collectif. Le patronat a inventé une forme d’entreprise individualisée. On pourrait imaginer une entreprise qui fonctionnerait différemment, de manière collective. L’entreprise c’est une juxtaposition d’individus qui ont signé un contrat de subordination avec l’employeur et c’est tout. Tout ce qui est collectif, rassemblement ou groupe, est présenté comme un ennemi.
L’individualisation, ça passe notamment par le salaire, en ne payant pas tout le monde de la même manière. Vous avez mené une lutte à ce sujet en publiant, en les anonymisant bien sûr, des fiches de paie dans vos tracts.
Ça n’a pas été facile à mettre en place parce que le salaire c’est vraiment personnel, c’était secret, et l’entreprise fait tout pour que ça le soit. Mais à force de publier des bulletins de salaire, ça a bouleversé tout un tas de choses et ça a contraint l’entreprise à créer une grille de salaire. On a obtenu la clarté et les gens qui étaient habitués au secret étaient satisfaits de voir que désormais il n’y avait plus de secret et on savait quels étaient les salaires dans l’entreprise.
En termes de salaires, les plus défavorisées c’étaient les femmes…
Oui, oui. J’ai été suffoqué de voir comment travaillaient les femmes dans l’atelier des ébauches, elles étaient debout toute la journée, elles devaient faire une pièce toutes les trois secondes, elles faisaient 6 000 à 7 000 pièces par jour. L’atelier était bruyant et l’atmosphère était affreuse, c’était tout recouvert d’un brouillard d’huile, parce que naturellement les machines marchaient avec de l’huile. Et c’étaient elles les moins payées.
Quelle était la proportion de femmes à l’usine Lip ?
On a beaucoup discuté là-dessus, en fait, il y avait une légère majorité d’hommes, mais dans la lutte, ce qu’on a vu, c’était une majorité de femmes.
Vous signalez d’ailleurs dans votre ouvrage que l’un des points importants du mouvement Lip, c’est la place qu’ont occupée les femmes.
On a eu beaucoup de difficultés à ce sujet parce que les femmes quand on leur proposait de devenir déléguées, de se présenter au vote, elles ne voulaient pas, parce qu’il y avait leur mari, parce qu’elles savaient qu’en rentrant chez elles, elles avaient encore du boulot, elles faisaient une double-journée. Elles étaient donc moins disponibles.
Dans ce mouvement il y a des femmes qui ont été au premier plan comme Monique Piton ou Fatima Demougeot.
Monique Piton, c’était une secrétaire de base, elle n’était pas déléguée syndicale, elle s’est révélée durant le mouvement. Ça rend modeste, parce que dans la lutte, on découvre des gens qu’on n’aurait jamais imaginés comme ça.
Fatima Demougeot était OS [ouvrière spécialisée] et elle était déléguée syndicale.
Est-ce que le fait que des femmes entrent dans la lutte a permis de faire apparaître des problèmes spécifiques liés à leur condition de femme ?
Nous, on s’est rendu compte, on le savait un peu, mais on a cru naïvement qu’on avait beaucoup discuté avec les femmes et qu’on avait compris leurs revendications, mais lorsqu’ on essayait de les mettre dans nos tracts, on voyait bien qu’on tombait à côté. C’étaient elles qui devaient faire leurs revendications et quand elles sont rentrées dans la lutte, ça été autre chose.
Dans votre livre vous insistez sur une de vos conceptions de la lutte qui consiste à associer les non-syndiqués au mouvement et à toutes les prises de décision.
Ce n’est pas simple, le syndicat à tout lieu d’être inquiet quand dans une lutte il y a des pouvoirs qui se créent qui ne sont pas liés au syndicat. Il y a des gens, comme Jean Raguénès, qui n’étaient pas du tout syndiqués qui sont venus dans la lutte, ils ont eu leur place et même une place assez importante parce qu’ils ont beaucoup travaillé et beaucoup apporté.
La bagarre avec le syndicat, c’était de leur expliquer que ça faisait des années qu’on se battait pour l’émancipation et que si des gens entraient dans la lutte, il fallait les accueillir et ne pas faire de différences entre ceux qui étaient syndiqués et ceux qui ne l’étaient pas. Tout le monde devait être à égalité. Ils doivent comprendre petit à petit pourquoi il faut se syndiquer mais ça c’est leur révolution à eux. On a été pas mal critiqués pour ça, mais on leur a dit : « regardez les résultats on était à 5%, on est passé à 70% rien que pour la CFDT ».
Dans la négociation, ça été encore plus difficile à faire admettre que ce n’était pas au syndicat de décider tout seul, et que si la majorité était contre ce que proposait le syndicat, il fallait reculer. Mais je comprends les réticences, nous on avait fait un travail tellement important dans l’entreprise que l’on pouvait se permettre ça. Il peut y avoir des groupes de personnes qui rêvent d’un type de société et qui ne sont pas suffisamment terre à terre.
C’est un pari qu’on a essayé de lancer en disant que ceux qui rentraient dans le mouvement ne devaient pas se sentir différents parce qu’ils n’étaient pas syndiqués, parce qu’ils étaient femmes, OS [ouvriers spécialisés], toute parole devait être écouté à l’assemblée générale. On voulait rappeler que toute personne avait sa place. On a eu des grosses surprises, des personnes de bas niveaux ont été supers dans cette lutte, elles ont été admirées, écoutées et puis d’autres de rangs plus élevés qui sont restées effacées.
On découvrait des gens qui donnaient beaucoup mais qui en rejoignant la lutte commençaient à réfléchir à ce qu’était cette société, le capitalisme…
Vous venez de citer, Jean Raguénès, un prête dominicain qui a participé à la lutte, mais j’ai été étonné que vous ne parliez pas dans votre livre des Chrétiens de gauche, pourtant vous veniez de ce mouvement ?
J’ai eu un parcours assez bizarre, mon père était protestant et non-pratiquant. Dans le bâtiment de la rue de la Madeleine [à Besançon] où j’habitais, les femmes se sont inquiétées de voir un gosse de sept ans qui n’allait pas au caté. On m’a donc baptisé et je suis allé au caté. Ensuite, quand mon père est mort, j’ai été recueilli par la famille Ubbiali qui était très chrétienne.
J’ai trouvé après quelque chose de très bon dans l’ACO, l’action chrétienne ouvrière. Cette idée de réfléchir, chaque soir, à comment s’est passée la journée, comment on s’est comporté avec tel ou tel ? Est-ce que je n’aurais pas pu mieux aider cette personne ? Plus l’écouter ? Ça m’a beaucoup apporté.
Puis en lisant, j’ai vu cette différence entre une Église de droite et une Église de gauche et j’en suis arrivé à la conclusion que la religion, c’était une invention comme une autre qui a pris, et il y en a d’autres qui n’ont pas pris…
Donc vous n’êtes plus croyant ?
Oui, depuis 1976.
Vous n’êtes plus croyant, mais vous l’étiez à l’époque donc culturellement ça vous a apporté quelque chose dans votre combat ?
Oui, et j’ai beaucoup de respect pour un certain nombre de croyants qui ont été formidables. Mais personnellement, après avoir réfléchi à tout ça, j’en arrive à la conclusion que l’on ne sait pas ce qu’il y a, mais que les religions ont été inventées.
J’ai été étonné que vous ne parliez pas de la grève à la Rhodia en 1967, ça n’a pas été inspiration pour vous ?
Oui peut-être que j’aurais dû le faire.
La Rhodia, c’était un peu notre modèle, c’était la plus forte section syndicale de la ville. C’est d’ailleurs eux qui ont organisé Mai 1968. Dans leur section, ils avaient des problèmes, ils avaient un leader qui était un peu cassant. Nous on avait commencé à réfléchir en se disant que quand il y a un leader, il y a un déficit démocratique.
J’avais aussi envie de parler du « Prévent de Bregille » en 1972[1], on avait déjà mis en place ce qu’on fera plus tard à Lip. On avait dit aux copines du « Prévent », nous on va juste apporter des idées, montrer les dangers, mais en définitive à chaque rencontre on s’en va et c’est vous qui décidez. C’était assez formidable ces filles qui se sont révoltées et ont mené une lutte pendant six mois.
Vous vous êtes retrouvé leader malgré vous, vous êtes la figure que l’on retient ?
C’était d’ailleurs pas bon, mais c’est comme ça que ça s’est passé. J’avais d’ailleurs pas mal de défauts, notamment le défaut du chef de service, je n’avais pas assez confiance, j’avais toujours peur qu’on ait du retard, que les choses ne soient pas faites à temps. J’étais un petit peu emmerdant et c’était un peu pareil dans le syndicat. Je savais qu’il fallait déléguer mais en même temps, j’avais de la peine. On m’a remis en place plusieurs fois, sévèrement d’ailleurs.
Vous racontez que l’on vous a suspendu de votre fonction de porte-parole pendant deux semaines parce que vous vous étiez un peu trop avancé auprès d’un journaliste.
Oui. Et combien de fois je me suis fait éjecter d’une activité avec les copains qui me disaientt : « arrête, fiche-nous la paix ». C’était juste… C’était mon caractère qui était pointilleux. Ce n’était pas bon, il faut avoir un caractère un peu plus ouvert.
Je reprends ce mot « ouvert », vous dites dans votre livre que c’est important d’être ouvert sur l’extérieur.
Oui, moi j’aurais dû être un peu plus ouvert. Cette ouverture, on avait été malheureux de ne pas l’avoir réussie en 1968, le personnel avait voté contre l’accueil des étudiants, ça été la catastrophe, on en a été malades. L’ouverture ce n’est pas facile, il faut que les salariés puissent la supporter. Quand on a ouvert à Lip, on a eu tous les Maos, toute l’extrême-gauche mais on était assez solides. Si on n’avait pas ouvert pendant le mouvement Lip, on n’aurait pas pu faire tout ce que l’on a fait.
D’ailleurs c’est vrai cette histoire des montres qui avaient été cachées dans les églises ?
Oui, il y a eu un couvent mais on a beaucoup brodé là-dessus. Moi, les copains n’avaient pas voulu me mettre dans l’équipe parce que je parlais trop. Et puis j’étais trop pointilleux. Une fois les ouvriers avaient bossé de nuit et on leur avait donné une montre, j’avais dit qu’il ne fallait pas commencer comme ça, il fallait qu’on soit tous à égalité. J’étais peut-être un peu trop rigoureux, Raymond [Burgy] m’avait dit qu’il fallait savoir lâcher un peu du lest.
C’est quelque chose qui n’apparaît pas dans votre livre mais les rapports avec les élus de la ville n’ont pas toujours été faciles, ils étaient plutôt critiques par rapport au mouvement, je pense à l’ancien maire Robert Schwint, son adjoint à l’économie Albert-Maxime Kohler ou encore à Joseph Pinard.
Ils ne le montraient pas forcément devant nous…
Joseph Pinard, c’est quelqu’un qui est inquiet dès que ça bouge, lorsqu’il se présentait aux législatives, il nous disait : « ça va effrayer le bourgeois, ça va mal se terminer dans les urnes ». Si on l’écoutait, il n’aurait presque jamais fallu bouger puisque les élections se succèdent tout le temps.
Même au sein du syndicat, on n’était pas très bien vus.
Vous êtes resté un militant et justement en lisant ce petit livre, clair et accessible, je me suis demandé si vous ne vouliez pas qu’il serve éventuellement aux jeunes pour inspirer leurs luttes futures ?
J’ai voulu faire le point par rapport à toutes les critiques mais j’ai écrit aussi ce livre pour faire changer les choses, mais je rêve là… Dans une entreprise les délégués forment un petit monde à part, il y a la lutte qui se passe une fois par mois avec la direction, on écrit des belles pages… Ça ne devrait pas être ça, le plus important c’est le travail de préparation, d’information, de formation des salariés pour arriver à ce que soit eux qui prennent le relais.
C’est beaucoup plus facile de dire : « je suis délégué, je lutte pour les salariés » alors que tu devrais luter AVEC les salariés. Tu es content d’aller discuter avec les responsables mais ça a plus de poids quand tous les salariés disent à un moment qu’ils ne sont pas d’accord. Mais pour ça, il faut faire tout un travail dans une entreprise où tout est calculé pour que ce soit individualisé. C’est pour ça que je suis un peu désabusé parce que je me dis que ça demande beaucoup de boulot. Et ce n’est pas gratifiant d’aller faire ce genre de boulot, alors qu’aller discuter avec la direction, ça l’est plus.
Aujourd’hui ce qui m’inquiète c’est l’écologie, quand on nous bassine avec la croissance, alors que 1% de croissance sur un millénaire c’est totalement impossible, ça multiplie la production initiale par 20 000. Je voudrais qu’on commence à réfléchir. Il n’y a peut-être pas de limite à la croissance du bonheur mais à la croissance matérielle, il y en a une. On va au-devant de catastrophes énormes. Le nord est en train de se réchauffer à une vitesse grand V, 47 degrés au Canada, 45 degrés à Moscou au mois de juin…
Vous avez une conscience écologique importante mais vous êtes resté aussi au plus près des mouvements sociaux, vous avez ainsi soutenu le mouvement des gilets jaunes.
Oui alors j’ai bien vu qu’ils n’avaient pas beaucoup de formation mais ils avaient quelque chose, ils ont dit « non », ils sont allés le dire dans la rue et ils ont été tenaces, ça c’est une qualité. Moi je dis : « bravo ». Tous ces gens-là sont intéressants. On se dit qu’il faudrait discuter avec eux pour peaufiner, mais bon on ne va pas faire les plus malins, la preuve, nous on n’a pas réussi.
Propos recueillis par Martial Cavatz
[1] Dans la notice consacrée à Charles Piaget dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Le Maitron, Georges Ubbiali indique : « la grève du « Prévent de Bregille » en 1972 {est un] conflit d’une durée de près de six mois, à Besançon, dans un Préventorium, structure sanitaire du quartier de Bregille, animé par des femmes salariées, soutenues par la CFDT. Ce conflit a donné lieu à une intense solidarité sur la ville, avec un comité de soutien très actif (sans la CGT, ni le PCF). », voir ici : https://maitron.fr/spip.php?article163717.